L’Europe spatiale fracturée entre stratégies française et allemande

La pression budgétaire sur l’industrie spatiale française face à l’offensive allemande
Alors que l’Allemagne investit fortement dans les activités spatiales, la France, moteur historique du secteur en Europe, se retrouve en difficulté pour suivre un tel rythme en raison de marges de manœuvre budgétaires limitées. La mise en scène par l’Elysée, lundi 17 novembre, d’annonces d’investissements d’entreprises françaises n’a pas dissipé les désillusions de la réindustrialisation du pays ni les tensions persistantes dans plusieurs filières comme l’automobile ou l’acier. L’industrie spatiale, dépendante des commandes publiques civiles et militaires, suscite des inquiétudes sur son avenir.
Cette visibilité accrue est intervenue le mercredi 12 novembre lorsque le chef de l’État a présenté une nouvelle stratégie nationale spatiale. Emmanuel Macron s’est engagé à augmenter le budget des activités spatiales de défense à 10,2 milliards d’euros jusqu’en 2030, contre 6 milliards annoncés initialement, tout en promettant « plus de 16 milliards d’euros pour le spatial français civil, en incluant les activités duales ». Une annonce destinée à encourager un secteur en difficulté et distancé par les Etats-Unis et la Chine, aussi bien dans les technologies de lanceurs que dans les constellations de satellites en orbite basse.
Malgré cette promesse, l’effort français reste très inférieur à celui de l’Allemagne. Berlin prévoit de consacrer 35 milliards d’euros aux seules activités spatiales de défense sur la même période, soit 3,5 fois plus que la France en incluant sa rallonge potentielle. Cet écart budgétaire important signale un bouleversement des équilibres spatiaux européens et fragilise une industrie française qui représente pourtant près de 40 pour cent des emplois du secteur en Europe.
Une recomposition européenne accélérée par la transition annoncée de l’ISS
Ce basculement se produit alors que la scène spatiale mondiale s’apprête à vivre une transition majeure. La Station spatiale internationale, entrée en service en 2000, approche de la fin de son cycle. La Nasa prévoit de la désorbiter en 2031 et a confié à SpaceX un contrat de près de 850 millions de dollars pour concevoir le United States Deorbit Vehicle, qui conduira l’ISS au contact de l’atmosphère avant sa destruction. Les débris restants rejoindront la zone isolée du Pacifique connue sous le nom de point Nemo. Quatre agences privées américaines ambitionnent de succéder à l’ISS, mais cette transition demeure incertaine.
Cette évolution du paysage mondial accentue les enjeux européens, au moment où l’équilibre interne se modifie entre France et Allemagne. Les rapports de force budgétaires influencent directement la capacité des industriels à s’imposer dans les futurs programmes spatiaux de l’Union européenne, essentiels pour leurs activités et pour la souveraineté technologique du continent.
La France en quête d’une position solide avant le sommet de l’ESA
À l’approche du sommet de l’Agence spatiale européenne de Brême, la France tente de préserver son rang tout en composant avec les ambitions allemandes. Emmanuel Macron a appelé à maintenir un niveau d’engagement à la hauteur du leadership français. Selon les négociations en cours, la contribution française pour le budget triennal 2026-2028 devrait atteindre 3,5 à 3,6 milliards d’euros. Ce montant, jugé maximal par l’État, est considéré comme un minimum par les industriels du secteur qui réclament 4,5 milliards d’euros.
Une légère hausse pourrait être obtenue grâce à l’utilisation de reliquats financiers non dépensés par l’ESA, permettant à Paris de dépasser légèrement les quatre milliards d’euros si les hypothèses budgétaires pour 2027 et 2028 sont jugées suffisamment solides. Cette enveloppe couvrirait notamment l’exploration spatiale, conformément aux orientations présidentielles.
Les discussions ont d’abord envisagé des montants inférieurs, entre 2,7 milliards défendus par le CNES et 3,3 milliards. Une campagne menée par les grands industriels à l’automne a contribué à relever les ambitions françaises afin de garantir le financement des programmes en cours, dont 1,8 milliard d’euros destinés à la filière lanceur. Le ministère des Armées, qui a renoncé au troisième satellite Syracuse 4C au profit du programme IRIS², pourrait également appuyer modestement la future constellation européenne soutenue par l’ESA.
Malgré cet effort, la France reste loin de l’engagement annoncé par l’Allemagne, qui vise au moins cinq milliards d’euros lors de la prochaine conférence ministérielle. L’Italie pourrait atteindre quatre milliards grâce au plan de relance européen de 2020, tandis que la Grande-Bretagne envisage une contribution d’environ 2,5 milliards. Dans ce contexte mouvant, la France doit défendre sa position dans un paysage spatial européen où les ambitions nationales s’affirment et où les rapports de force se réajustent en permanence.
Source : Le Monde, La Tribune, Challenges
Contributeurs
Chaque jour, nous sélectionnons pour vous, professionnels de la gestion d'actifs, une actualité chiffrée précieuse à vos analyses de marchés.
Statistiques marchés, baromètres, enquêtes, classements, résumés en un graphique ou une infographie dans divers domaines : épargne, immobilier, économie, finances, etc. Ne manquez pas l'info visuelle quotidienne !
Les graphs commentés les plus consultés :
Croissance 2025 : l’Europe à plusieurs vitesses selon Bruxelles
Le cacao à prix d’or : pourquoi le chocolat coûte (beaucoup) plus cher
Un outil pratique mis à votre disposition pour découvrir et vous inscrire aux prochains événements de nos partenaires : webinars, roadshow, formations, etc.

.webp)






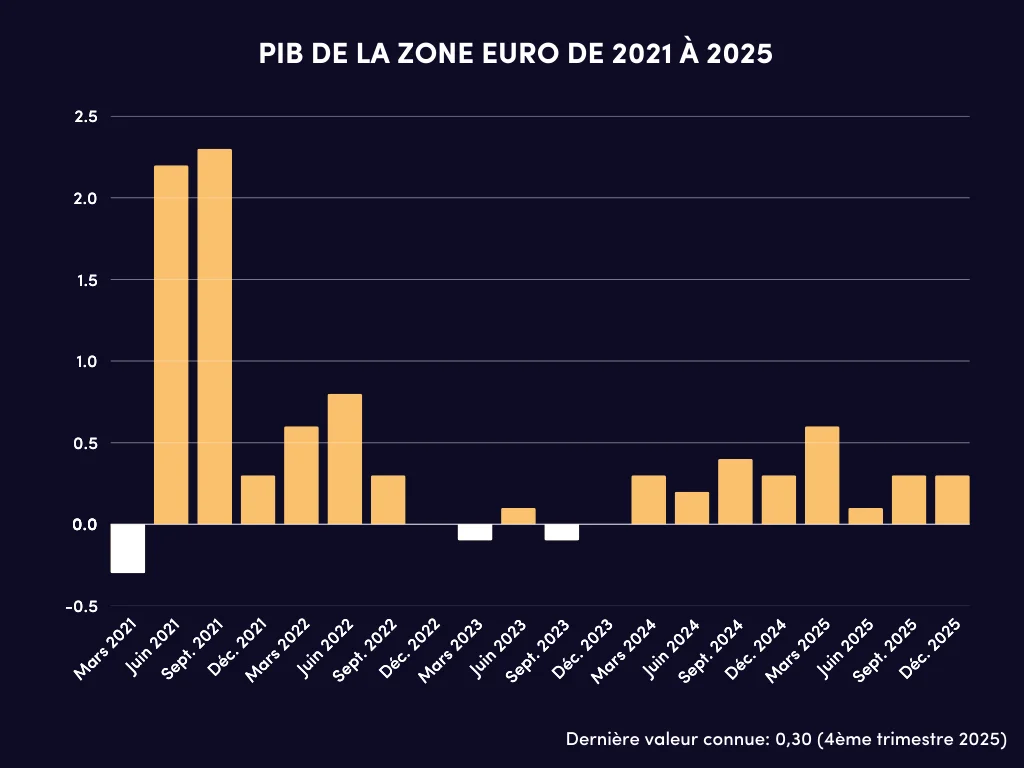



.webp)

















