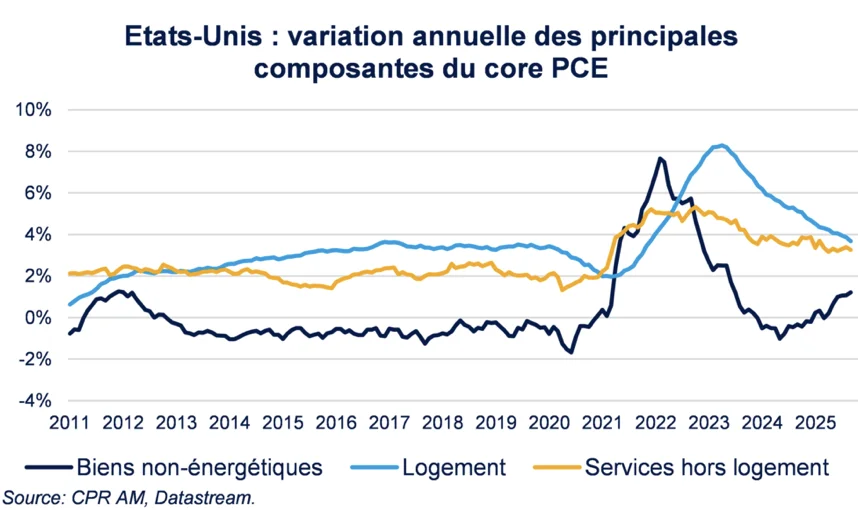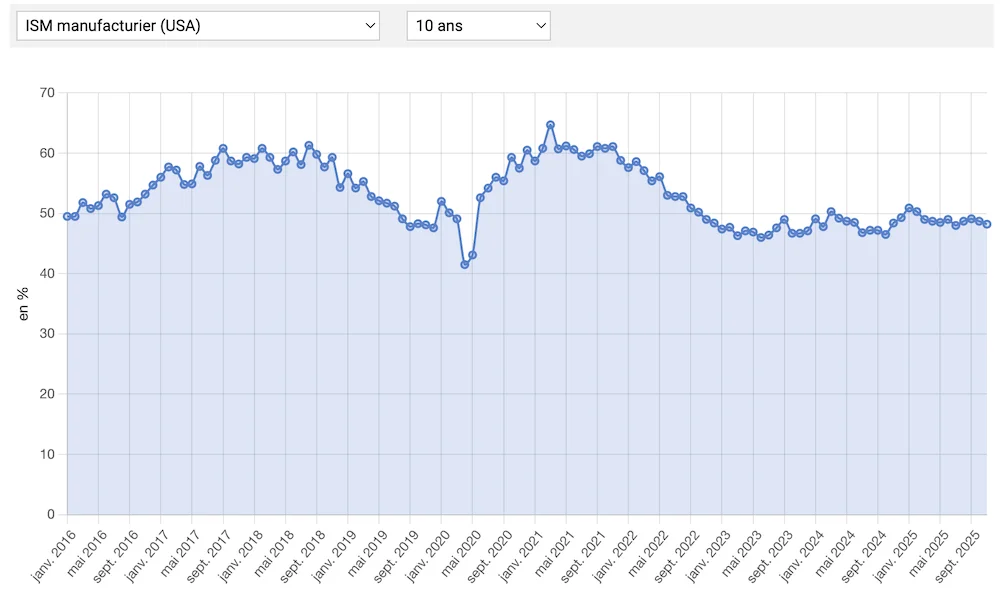Graph du jour : évolution du nombre de séniors en situation de dépendance


Au 1er janvier 2024, les plus de 75 ans représentent, selon l’INSEE,10,4 % de la population. À horizon 2050, cette proportion devrait dépasser les 16 % pour s’établir à 16,4 %.Dans le cadre des projection établies par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), l’hypothèse intermédiaire prévoit que le nombre de séniors en situation de dépendance compte 384 000 personnes de plus entre 2019 et 2030. La France dénombrerait ainsi près de 3 millions de personnes âgées dépendantes en 2030, sur un total de 21 millions de personnes âgées de plus de 60 ans. Toujours en s’appuyant sur cette hypothèse intermédiaire de la DREES, ce chiffre atteindrait 3,6 millions à horizon 2050 (3,3 millions dans l’hypothèse "optimiste", 4,2 millions en hypothèse "stable" et 4,8 millions en hypothèse "pessimiste").
Si le maintien à domicile est privilégié, tant par les Français que par les pouvoirs publics, les séniors se trouvant dans l’incapacité de rester dans leur logement sont généralement orientés vers des établissements spécialisés et médicalisés ou vers les résidences autonomie.
Les Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) : un choix incontournable mais coûteux
Les EHPAD demeurent aujourd’hui l’alternative prédominante au maintien à domicile quand ce dernier ne peut pas être proposé. En 2019, 730 000 personnes, soit 10 % des plus de 75 ans, vivaient e EHPAD. Ces établissements accueillent des résidents souvent très dépendants, avec des besoins médicaux et sociaux complexes.Réservés, sauf cas exceptionnels(sur dérogation), aux personnes de60 ans et plus, les EHPAD comptent néanmoins 3 % de résidents ayant intégré un établissement avant leurs 60 ans.L’entrée en EHPAD a un coût élevé pour les résidents et leurs familles.Malgré des aides sociales comme l’APA et l’aide sociale à l’hébergement (ASH), le reste à charge reste souvent important. La DREES souligne à ce titre, la nécessité pour les pouvoirs publics de corriger les inégalités d’accès actuelles, notamment en fonction des ressources des individus.
Les résidences autonomie ou résidences de services : des alternatives à développer
Entre les EHPAD et la prise en charge à domicile, se développent des solutions intermédiaires à travers les résidences autonomie ou les résidences de services. Ces structures d’accueil proposent prioritairement des logements à des personnes âgées autonomes ou modérément dépendantes. Ces lieux de vie se caractérisent par la mise à disposition d’un logement privatif (type studios, F1 ou F2) des espaces communs et une offre de prestations de services variées à destination des résidents. La particularité des résidences autonomie tient à la présence d’un cadre réglementaire relevant de la sphère médico-sociale plus stricte que dans les résidences de services.De fait les résidences autonomie sont habilitées à accueillir des séniors très dépendants sous réserve d’en limiter l’accès à un nombre restreint de résidents (15 %maximum) et d’avoir conclu une convention de partenariat avec un EHPAD et au moins un des acteurs sanitaires ou médico-sociaux ou un établissement de santé.
Contributeurs
Chaque jour, nous sélectionnons pour vous, professionnels de la gestion d'actifs, une actualité chiffrée précieuse à vos analyses de marchés. Statistiques, études, infographies dans divers domaines : épargne, immobilier, économie, finances, etc. Ne manquez pas l'info visuelle quotidienne !
Ne loupez aucun événement de nos partenaires : webinars, roadshow, formations, etc. en vous inscrivant en ligne.

.webp)