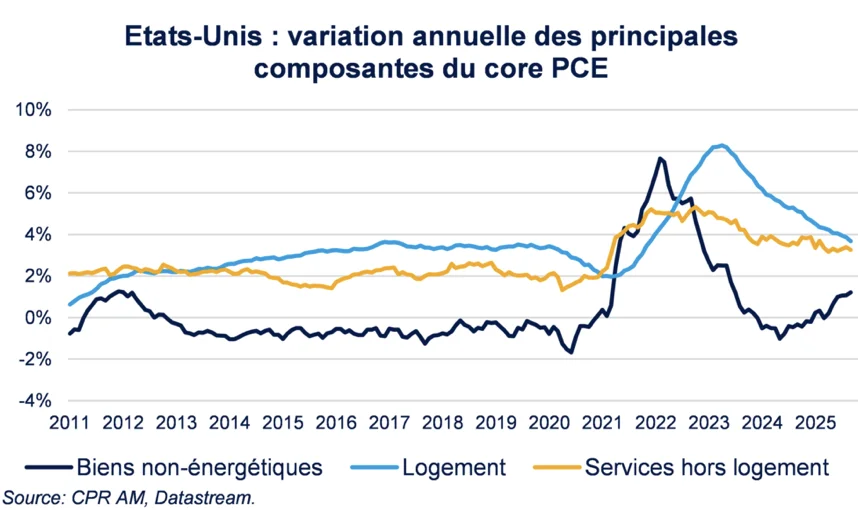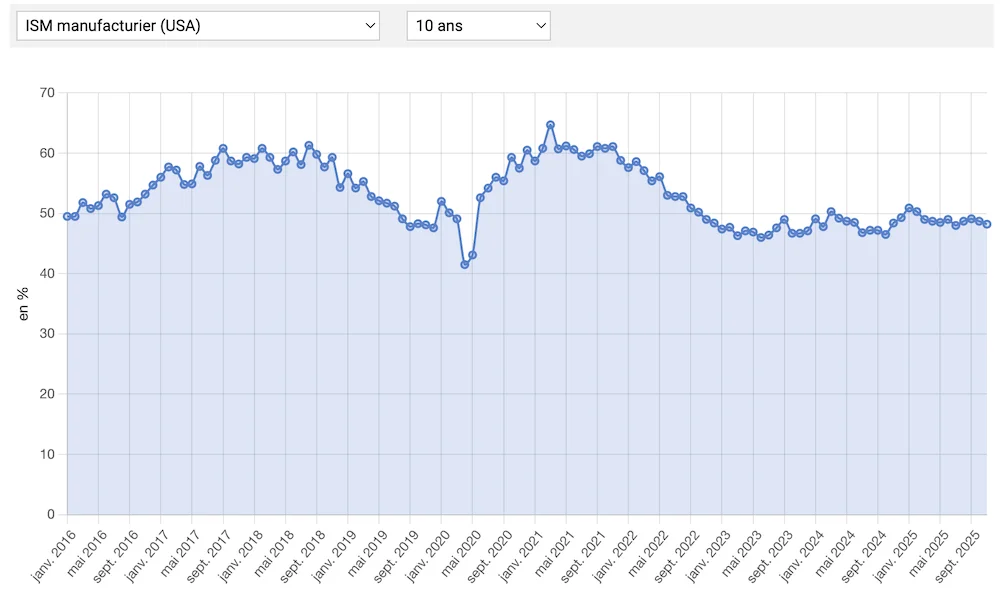Les plus fortes baisses du S&P500 sur 3 jours depuis 1945


Retour sur la chute des marchés
Un grand bruit ? si, si…
Plus les corrections boursières sont fortes, plus les médias généralistes en parlent. Car au fond, quand la bourse va bien, nous ne retrouvons pas au 20h des grandes chaînes des reportages au pied des tours de La Défense pour expliquer que les marchés montent ! Non, quand il y a les tours de La Défense au 20h, en général, c’est que les marchés financiers baissent, et souvent, fortement. Et souvent, c’est à ce moment que survient la question du journaliste à l’expert boursier qui intervient en plateau comme les généraux interviennent pendant les guerres : « Assistons-nous à un krach ?!? ». Le mot est lâché… le « krach ».
Une plongée historique dans l’étymologie du mot krach
Oui, nous avons assisté à un krach
Afin de prendre un peu de recul dans ces marchés extrêmement volatiles, et parce que vous expliquer que la bourse a baissé à cause des « tariffs » serait vous faire offense (même si évidemment nous pourrions pousser l’analyse plus loin comme nous le faisons chaque semaine dans le Fundesys Hebdo), nous nous sommes penchés sur l’étymologie du krach. Certes, de façon très concrète, un krach se définit par une baisse rapide et brutale du prix des actions du fait d’une panique soudaine ou d’un élément déclencheur. En ce sens, comme nous pouvons le voir ci-dessous, la baisse en trois jours que nous venons de subir sur les actions américaines (mais pas que !) se positionne assez bien dans le tableau d’honneur des plus mauvaises performances boursières sur trois jours depuis 1945 :

Lire aussi : Chute des marchés mondiaux : les annonces de Trump sur les droits de douane déclenchent la panique
Un krach avec « ch »
Mais revenons à notre étymologie. Vous l’aurez remarqué, « krach » se termine en « ch » et non en « ck ». C’est donc une origine germanique et non anglophone qui nous anime quand le marché dévisse brutalement. Mais pourquoi donc ? C’est l’économiste Jean-Marc Daniel qui m’a éclairé sur le sujet. Vérifications faites en sus, voici donc l’histoire du « krach ».
En allemand, « krach » est une onomatopée qui est une imitation sonore d’un craquement ou d’un choc violent, un grand bruit en sorte. Mais quel rapport me direz-vous ? Et bien c’est là que l’histoire intervient.
Un retour à la fin du xixe siècle
Dans les années suivant la guerre austro-prussienne (1866) et la création de l’Empire austro-hongrois (1867), Vienne devient un centre financier majeur. Les investissements immobiliers sont colossaux, le réseau ferroviaire se développe à une vitesse fulgurante, et les actions industrielles connaissent une forte hausse en bourse. On assiste alors à une bulle spéculative typique.
Cependant, en mai 1873, cette bulle éclate soudainement. La bourse de Vienne s’effondre, marquant l’un des premiers krachs mondiaux. La panique se propage rapidement à Berlin, Paris et même New York. Cet événement marque le début d’une longue dépression économique en Europe et aux États-Unis, parfois qualifiée de « grande dépression du xixe siècle », qui durera jusqu’en 1879, voire au-delà.
Mais Salomon, qu’est-ce que ce krach ?!
Selon l’anecdote racontée par Jean-Marc Daniel, l’empereur François-Joseph d’Autriche, époux de Sissi pour la petite histoire, alors âgé de 42 ans, avait non loin de son palais le siège de la principale banque d’affaires de Vienne, celle d’un certain Salomon Mayer von Rothschild. Le 9 mai 1873 au matin, un vacarme impressionnant envahissait la rue sous les fenêtres de l’empereur. La crise boursière avait provoqué ce que nous appelons aujourd’hui un « bank run », ou autrement dit, une « course » des clients des banques vers leurs guichets pour retirer leur argent de peur qu’il disparaisse. Et à l’époque, les clients des banques retiraient… de l’or.
François-Joseph convoque alors M. de Rothschild et lui demande pourquoi tant de bruit devant sa banque. Le banquier explique que la bourse s’effondre et que les clients veulent récupérer leur or. En septembre 1873, la crise atteint la bourse de New York qui ferme et provoque un nouveau bank run. M. de Rothschild retourne voir l’empereur inquiet de savoir s’il y allait avoir de nouveau tout ce bruit sous ses fenêtres, un nouveau « krach »… Et le banquier lui rétorque : « oui, nous allons connaître un nouveau krach »… Le mot entrait ainsi dans le vocabulaire boursier… Si, si…
Par Gérald Grant, Fundesys
Lire aussi :
Prévisions des maisons de Wall Street pour le S&P 500 à fin 2025
Le S&P 500 voit sa performance soutenue par de plus en plus de valeurs
Chaque jour, nous sélectionnons pour vous, professionnels de la gestion d'actifs, une actualité chiffrée précieuse à vos analyses de marchés. Statistiques, études, infographies dans divers domaines : épargne, immobilier, économie, finances, etc. Ne manquez pas l'info visuelle quotidienne !
Ne loupez aucun événement de nos partenaires : webinars, roadshow, formations, etc. en vous inscrivant en ligne.

.webp)