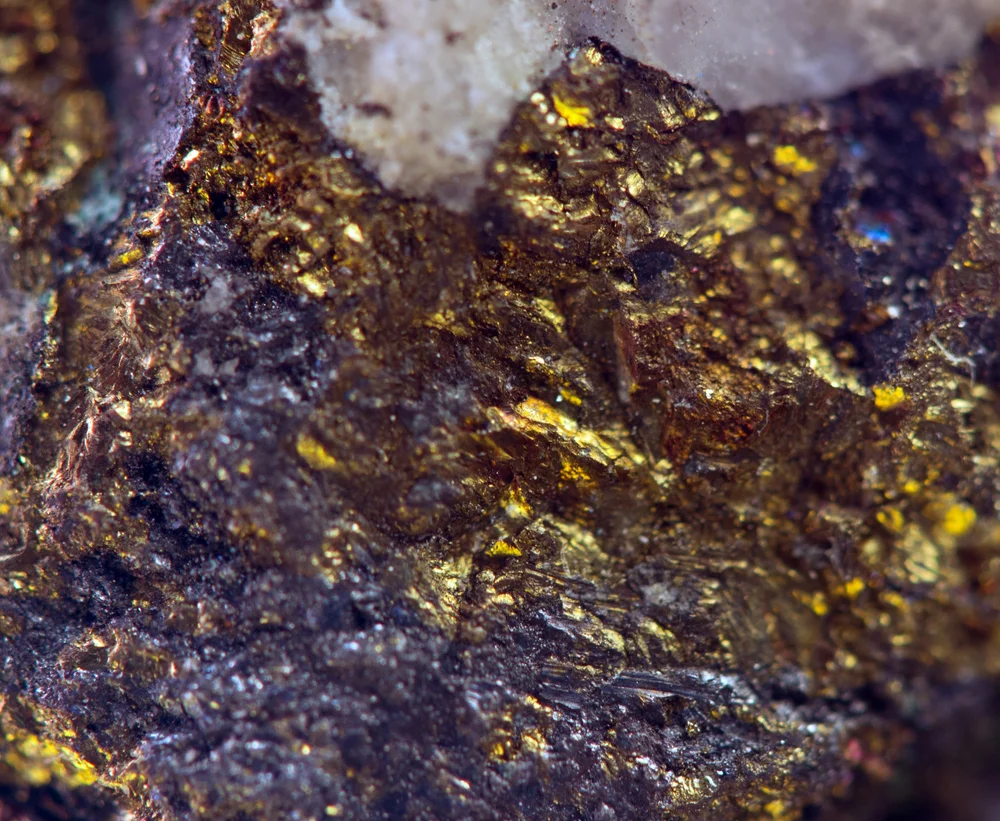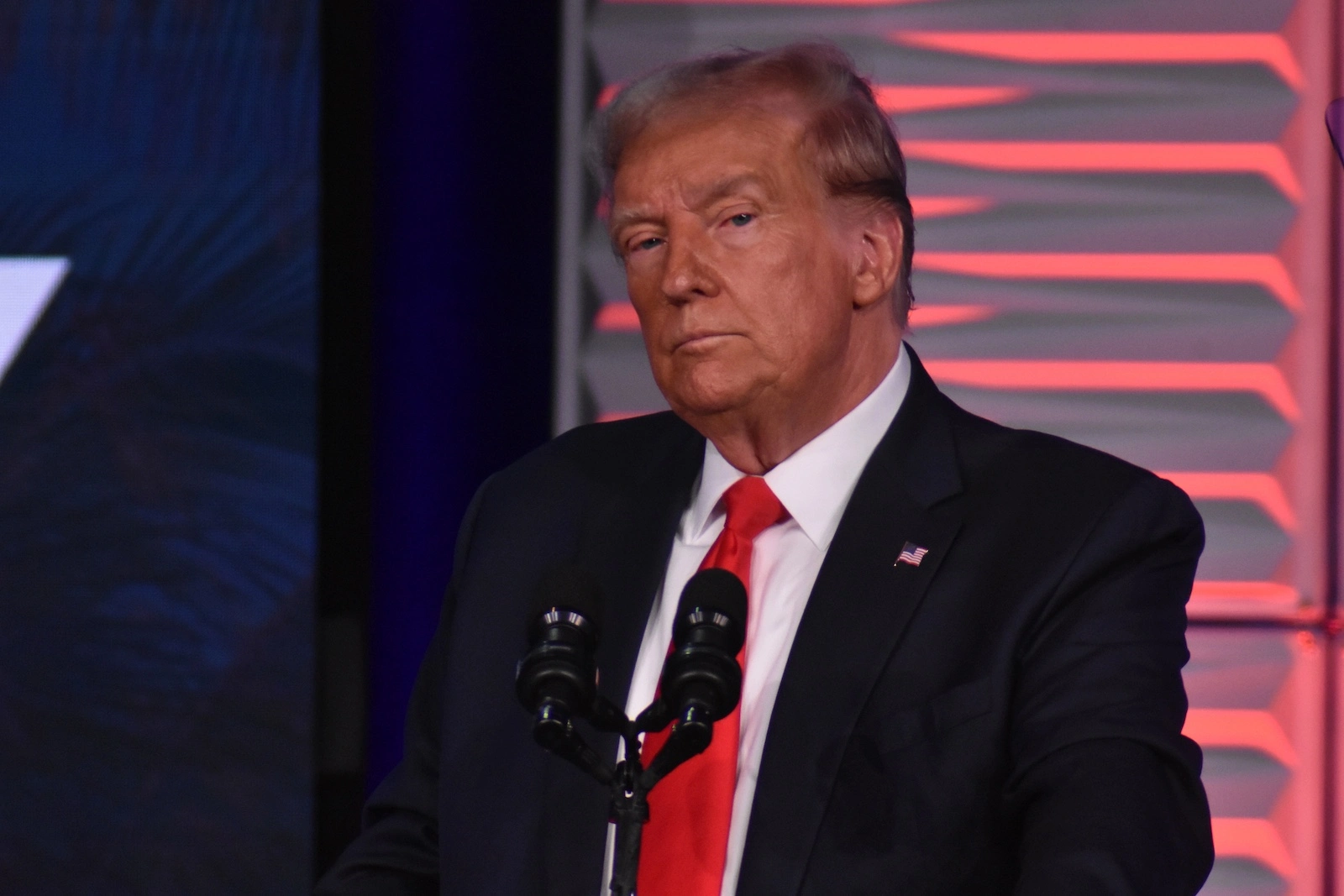Exonération des plus-values : les recettes exceptionnelles à inclure

Le régime de l’article 151 septies du CGI : une exonération conditionnée au montant des recettes
L’article 151 septies du Code général des impôts permet, sous conditions, l’exonération des plus-values professionnelles réalisées lors de la cession d’une entreprise ou d’une branche complète d’activité.
L’un des principaux critères d’éligibilité à ce régime repose sur le montant des recettes annuelles réalisées par l’entreprise.
Le seuil est fixé à :
- 250 000 € pour les prestataires de services,
- 90 000 € pour une exonération partielle dans ce cas,
- 350 000 € pour les activités d’achat/revente, d’hébergement ou de vente à consommer sur place,
- 126 000 € pour une exonération partielle.
Mais la définition exacte de ce que recouvrent ces “recettes annuelles” est source d’incertitude. Faut-il inclure les produits issus de la cession d’éléments de l’actif immobilisé ? Et si oui, dans quels cas ces produits doivent-ils être considérés comme des recettes “normales et courantes” au sens fiscal ?
La jurisprudence du Conseil d’État : une lecture économique de la notion de recettes
Dans une décision du 26 juillet 2023 (n° 466220), le Conseil d’État s’est prononcé sur une question voisine, dans le cadre de la contribution sociale. Il a retenu que les recettes à prendre en compte sont :
« celles tirées de l’ensemble des opérations réalisées par l’entreprise dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, le cas échéant eu égard à son modèle économique. »
Cette formule ne se limite pas à la nature comptable des produits (courants ou exceptionnels) mais s’attache à l’analyse fonctionnelle de l’opération dans l’activité réelle de l’entreprise.
Cette position a ensuite été reprise, presque mot pour mot, par la cour administrative d’appel de Paris dans sa décision du 28 mars 2025 (n° 23PA05320).
La décision de la CAA de Paris : les recettes exceptionnelles peuvent relever de l’activité normale
Dans cette affaire, la cour était saisie du cas d’une société de travaux agricoles ayant réalisé des cessions de matériels agricoles. Ces cessions étaient enregistrées comme produits exceptionnels en comptabilité.
La question posée était la suivante :
Ces ventes de matériels doivent-elles être prises en compte pour apprécier le seuil de recettes conditionnant l’exonération des plus-values professionnelles ?
La cour répond oui, dès lors que ces ventes :
- interviennent dans le cycle normal de renouvellement des immobilisations,
- et sont inhérentes au fonctionnement habituel de l’activité exercée.
Elle en conclut que le traitement comptable des produits (en “exceptionnels”) ne suffit pas à les exclure du champ des recettes fiscales, dès lors qu’ils sont structurellement intégrés au modèle économique de l’entreprise.
Une position contraire à celle de l’administration fiscale
La doctrine administrative (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20, §390) adopte une position plus restrictive. Elle précise que :
Il convient de ne pas tenir compte, pour apprécier les seuils de recettes, des produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.
Autrement dit, l’administration exclut par principe les produits de cession d’immobilisations, sans distinction selon leur fréquence ou leur lien avec l’activité.
La cour relève explicitement cette divergence. Elle rappelle que cette doctrine reste opposable aux contribuables sur le fondement de l’article L 80 A du Livre des procédures fiscales, tant qu’elle n’a pas été retirée.
Une clarification utile pour les professionnels du chiffre
L’enjeu pratique de cette jurisprudence est important :
- Elle confirme que le traitement comptable (exceptionnel ou non) n’est pas déterminant,
- Elle impose de vérifier si l’opération s’inscrit dans l’exploitation normale de l’entreprise,
- Elle appelle à une analyse fonctionnelle du modèle économique pour déterminer si certaines ventes ponctuelles (matériels, véhicules, actifs...) doivent être considérées comme des recettes.
Ce raisonnement rapproche le régime d’exonération de l’article 151 septies des règles applicables en matière de chiffre d’affaires ou de contribution sociale, en harmonisant les critères autour de la notion d’activité normale.
Sécuriser le traitement fiscal : l’option du rescrit
Face à la divergence persistante entre la doctrine administrative et la jurisprudence, le recours au rescrit fiscal peut offrir une solution sécurisée.
Cette procédure permet d’obtenir, en amont, une prise de position formelle de l’administration sur l’inclusion ou non de certaines recettes dans le seuil de l’article 151 septies.
Elle peut s’avérer particulièrement pertinente lorsque l’entreprise réalise ponctuellement des cessions d’actifs, mais que ces opérations s’inscrivent de manière récurrente dans son fonctionnement économique.
Sources : Lexisnexis, Legavox, Lexcalibur
Lire aussi :
Donation de titres sociaux d'un actif professionnel : le piège des plus-values
Donation d’un contrat de capitalisation en démembrement : pas de purge de la plus-value latente
Contributeurs
Chaque jour, nous sélectionnons pour vous, professionnels de la gestion d'actifs, une actualité chiffrée précieuse à vos analyses de marchés.
Statistiques marchés, baromètres, enquêtes, classements, résumés en un graphique ou une infographie dans divers domaines : épargne, immobilier, économie, finances, etc. Ne manquez pas l'info visuelle quotidienne !
Les graphs commentés les plus consultés :
Croissance 2025 : l’Europe à plusieurs vitesses selon Bruxelles
Le cacao à prix d’or : pourquoi le chocolat coûte (beaucoup) plus cher
Un outil pratique mis à votre disposition pour découvrir et vous inscrire aux prochains événements de nos partenaires : webinars, roadshow, formations, etc.

.webp)