Le PER individuel : de l’autonomie apparente du droit fiscal au principe de connexité des droits spéciaux


Le droit fiscal revendique depuis toujours son autonomie. Il se veut indépendant des autres branches du droit, forgeant ses propres concepts et son propre langage, ses propres règles de fonctionnent et sa propre méthodologie.
Mais cette indépendance, utile pour des raisons de rendement et de technique budgétaire, devient source d’erreurs dès lors que la matière imposable dépend d’un régime juridique plus complexe issus d’autres droits, commun ou spéciaux, tel que le droit des assurances appliqué au Plan d’Épargne Retraite Individuel (PER). C’est ce qu’on appelle la connexité des droits spéciaux, l’un ayant de l’influence sur l’autre, s’attirant et se repoussant à la fois, comme des électrons libres en perpétuel mouvement mais sans jamais réussir, si ce n’est à se comprendre, à se rejoindre.
Le PER illustre à la perfection cette tension : produit d’assurance ou d’épargne ? Droit rachetable ou non ? Bien commun ou propre ? Soumis à l’IFI ou non ?...
Autant de questions qui démontrent que la fiscalité, prise seule dans son mode de fonctionnement et son application, ne peut plus être pensée isolément : le temps est venu de passer de l’autonomie proclamée à la connexité assumée. Elle doit s’ancrer dans la qualification juridique des droits qu’elle prétend régir.
L’autonomie du droit fiscal : une indépendance fonctionnelle, non ontologique
Une revendication historique de l’administration
Depuis les années 1900, l’administration fiscale défend le principe d’autonomie du droit fiscal.
Cette autonomie repose sur une idée simple : la fiscalité a pour objet non pas de décrire le droit, mais de prélever sur les faits économiques. Elle doit donc pouvoir définir ses propres notions — revenu, patrimoine, valeur, disponibilité — sans être prisonnière des catégories du droit, que ce soit civil ou autres.
Cette indépendance conceptuelle répond à une finalité claire : l’efficacité de la collecte. Elle permet à l’administration de s’émanciper des débats juridiques pour imposer selon la réalité économique, ce qui a justifié, par exemple, l’imposition de revenus “fictifs” ou de valeurs latentes.
Mais ce pouvoir d’interprétation, né de la nécessité de prélever, s’est progressivement transformé en dogme. Et comme tout dogme, il tend à ignorer la complexité du réel, et son interdépendance aux autres droits.
Une autonomie instrumentale, pas hermétique
En réalité, le droit fiscal ne flotte pas dans le vide : il s’appuie toujours sur une matière juridique préexistante.
Le revenu fiscal suppose un droit de créance ; la plus-value suppose un droit de propriété ; la transmission suppose une dévolution successorale ou contractuelle. Le fiscal n’arrive qu’en second.
L’autonomie du droit fiscal n’est donc qu’instrumentale : elle vise à adapter les notions d’autres droits à la finalité budgétaire.
L’exemple de l’assurance-vie et du PER sont emblématiques.
• Sur le plan civil, le souscripteur ne dispose pas des actifs du contrat : il détient un droit personnel (créance) contre l’assureur.
• Sur le plan fiscal, le fisc considère pourtant que pour les assurances vie, la valeur de rachat fait partie du patrimoine imposable à l’ISF (désormais IFI), ou que les supports immobiliers soient soumis à l’IFI en phase d’épargne d’un PER assurance dès que le contrat devient rachetable, peu importe que celui-ci soit réellement racheté ou non.(Réponse ministérielle Malhuret 09/02/2023 à la question écrite n°01956)
• Ou encore l’assiette de taxation réduite de l’article 990 I à la dernière année de cotisations en cas de dénouement par décès du PER Assurance en phase d’épargne.
Cette dissociation volontaire illustre la puissance – mais aussi les limites – de l’autonomie fiscale : elle permet de taxer, mais au prix d’une fiction juridique.
Il faut donc d’abord qualifier juridiquement (prime déductible ou non, phase d’épargne ou non…) avec d’appliquer les principes et règles de fiscalité.
Le retour des droits spéciaux : la connexité comme exigence de cohérence
Le PER, terrain d’épreuve de la connexité
La réforme de l’épargne retraite, et la création du Plan d’Épargne Retraite (PER) par la loi PACTE, ont brutalement réintroduit le droit fiscal dans le champ du droit assurantiel.
En effet, le PER n’est pas un produit purement financier : il est encadré par le Code des assurances, le Code monétaire et financier, et le Code du travail selon sa déclinaison (individuel, collectif, obligatoire).
Or, la fiscalité du PER dépend entièrement de la qualification juridique du contrat.
Deux distinctions suffisent à le démontrer :
• PER assurance rachetable ou non rachetable ?
En phase d’épargne, le contrat n’est pas juridiquement rachetable : le souscripteur ne peut disposer des fonds hors cas prévus par la loi de sorties anticipées.
• Cette absence de rachat transforme totalement le raisonnement fiscal : on n’est plus en présence d’un contrat de capitalisation, mais d’un contrat non rachetable à prestations différées.
• Dénouement du contrat par décès : quelle assiette taxable ?
La doctrine administrative a longtemps hésité.
Certains y voyaient une assimilation à l’assurance-vie, et donc une taxation sur la valeur totale (primes + intérêts).
Or, la nature non rachetable du PER interdit cette assimilation :
o L’article 990 I du CGI ne vise que les “contrats d’assurance-vie ou assimilés”.
o En cas de décès, la seule somme juridiquement exigible est celle correspondant aux primes versées la dernière année, et non la valeur globale du contrat.
Cette analyse, confirmée par un rescrit fiscal (et demain le BOFiP et le ministère des finances), illustre parfaitement ce principe de connexité : c’est la qualification juridique du contrat qui détermine la fiscalité applicable, et non l’inverse.
Lire aussi : PER : un plafond fiscal plus souple et la liberté de conserver son contrat
La qualification juridique, préalable nécessaire à tout raisonnement fiscal
Chaque fois que le droit fiscal prétend s’autonomiser, il court le risque d’une double imposition ou d’une incohérence.
Ainsi, qualifier le PER de contrat rachetable aurait conduit à taxer des sommes indisponibles juridiquement — une violation du principe même de capacité contributive.
Le raisonnement correct, fondé sur la connexité, consiste à :
1. Identifier la nature juridique du droit (assurance, capitalisation, retraite, etc.) ;
2. En déduire les effets patrimoniaux (droit de rachat, de créance, de restitution) ;
3. Déterminer ensuite le fait générateur fiscal (versement, rachat, décès, service de rente).
Autrement dit, le droit fiscal doit suivre le droit spécial qui fonde le rapport économique.
Le PER rend cette hiérarchie évidente : sans qualification assurantielle, bancaire ou financier, impossible de comprendre ni la déductibilité à l’entrée, ni la taxation à la sortie, ni la fiscalité décès, ni la base imposable à l’IFI.
Vers une hiérarchie raisonnée : la fiscalité comme prolongement des droits spéciaux
De la méthode à la norme
Ce qui n’était au départ qu’une méthode d’analyse devient un principe structurant.
La connexité entre droit fiscal et droit spécial doit être reconnue comme une exigence de sécurité juridique.
Elle protège :
• le contribuable, en garantissant la prévisibilité de la charge fiscale ;
• l’administration, en assurant la cohérence des assiettes ;
• et le droit lui-même, en évitant que le fisc ne s’isole dans une logique purement comptable.
Dans le cas du PER, cette connexité a des effets concrets :
• elle fonde la distinction entre PER assurance (non rachetable/rachetable) et PER compte-titres (rachetable) ;
• elle justifie la fiscalité dérogatoire des capitaux décès ;
• elle clarifie la nature juridique du PER dans les régimes matrimoniaux : bien propre dès lors que l’épargne est attachée à la personne du titulaire.
Autant de domaines où la fiscalité ne peut se comprendre qu’à la lumière du droit civil et assurantiel.
Le fiscaliste, juriste des connexions
La spécialisation croissante du droit patrimonial rend cette approche incontournable.
Le fiscaliste d’aujourd’hui n’est plus un technicien du barème, mais un juriste transversal, capable de naviguer entre le CGI, le Code des assurances et le Code civil.
Il ne s’agit plus de raisonner “contre” le droit, mais “avec” lui.
Dans cette perspective, l’autonomie du droit fiscal apparaît pour ce qu’elle est : une autonomie apparente.
Son efficacité repose sur la solidarité fonctionnelle des autres droits et nous, comme l’administration fiscale, devons en tenir compte, que ce soit, pour notre part, dans notre approche praticienne, ou par l’administration fiscale, dans ses prochaines réponses.
Je ne saurai, si ce n’est concevoir, admettre une réponse autonome du droit fiscal sans tenir compte du principe de connexité des droits, à une question pourtant simple de savoir si, oui ou non, un PER assurance en phase d’épargne, peut redevenir non rachetable passé le délai de 2 années à compter de l’évènement ayant donné naissance à son rachat (accident de la vie, achat d’une résidence principale), permettant alors de sortir de l’assiette taxable IFI, les supports immobiliers sous-jacents détenus via le PER assurance (Voir pour plus de précision: article AUREP: PER et IFI – Novembre 2025 –Benoît BERCHEBRU).
Car dans le cas inverse, l’administration se fondant sur l’autonomie du droit fiscal, pourrait retenir que le PERin assurance est bien rachetable à tout moment, donc soumis à l’IFI à vita viternam, pour la quote part des supports immobiliers, dès la survenance du seul droit de rachat par anticipation, alors que le droit des assurances interdirait de racheter le PER par anticipation durant la phase d’épargne au-delà de la deuxième année ayant donnée naissance à ce droit. Une situation qui serait
alors très cocasse, l’administration pouvant retenir que le contrat est rachetable, alors qu’il ne serait plus possible de le racheter réellement !
Conclusion
L’autonomie du droit fiscal a longtemps été perçue comme une conquête.
Mais à mesure que les produits patrimoniaux deviennent hybrides – à la fois civils, financiers et assurantiels – cette autonomie se transforme en fragilité.
Le Plan d’Épargne Retraite en est la meilleure démonstration :
• il oblige à reconnaître la primauté du droit des assurances pour définir la nature des droits ;
• il impose de relier la fiscalité au fait générateur juridique réel ;
• il consacre, en pratique, un principe de connexité entre les droits spéciaux et le droit fiscal.
Ainsi, loin d’être un reniement, la connexité est l’achèvement de la maturité fiscale.
Elle permet au droit fiscal de rester fidèle à sa vocation première — traduire juridiquement, et non contredire, la réalité des droits.
Avis de l’auteur
La connexité devient un principe structurant, garant de cohérence et de sécurité juridique. La fiscalité suit le droit, et non l’inverse. Le droit fiscal ne doit pas ignorer le droit, mais en être l’expression comptable.
En matière d’assurance-vie comme de PER, il faut d’abord qualifier le contrat et sa phase (rachetable / non rachetable, épargne / service) avant de tirer les conséquences fiscales, démontrant que la fiscalité est le prolongement de certains autres droits (commun ou spéciaux), et non un régime autonome.
En ces moments de projet de loi de finances pour 2026 et de forte instabilité fiscale, le temps nous dira si nous aurons raison ou non.
Par Benoît BERCHEBRU, Directeur de l’ingénierie patrimoniale Astoria Groupe
Lire aussi :
Le Plan d’ Épargne Retraite des TNS : quel est le véritable plafond disponible ?
Les rêves de retraite assombris par l’inflation et l’incertitude en 2025
La planification des revenus de retraite : résultats clefs de l'enquête de Janus Henderson Investors
Quelle est la différence entre PER individuel et PER collectif ?
Contributeurs
Chaque jour, nous sélectionnons pour vous, professionnels de la gestion d'actifs, une actualité chiffrée précieuse à vos analyses de marchés.
Statistiques marchés, baromètres, enquêtes, classements, résumés en un graphique ou une infographie dans divers domaines : épargne, immobilier, économie, finances, etc. Ne manquez pas l'info visuelle quotidienne !
Les graphs commentés les plus consultés :
Croissance 2025 : l’Europe à plusieurs vitesses selon Bruxelles
Le cacao à prix d’or : pourquoi le chocolat coûte (beaucoup) plus cher
Un outil pratique mis à votre disposition pour découvrir et vous inscrire aux prochains événements de nos partenaires : webinars, roadshow, formations, etc.

.webp)






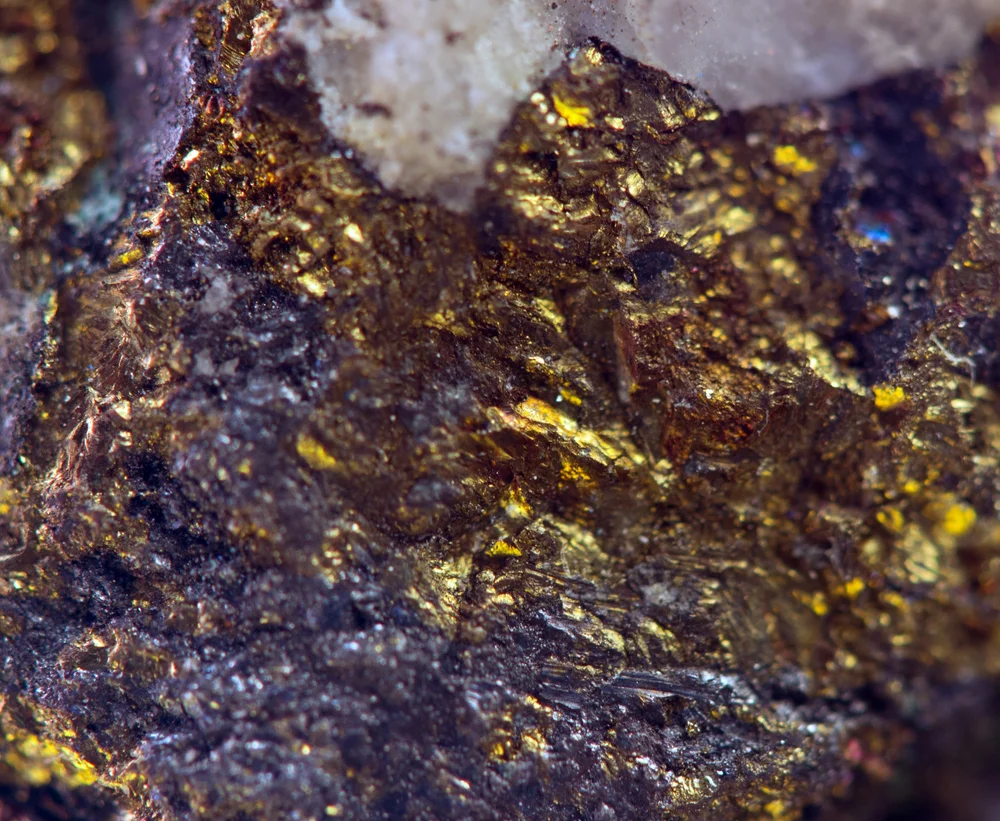










.webp)

















