Le pétrole en baisse : un risque accru pour la transition énergétique

Une chute du baril qui modifie l’équilibre économique mondial
Le pétrole, qui s’échangeait encore à 78 dollars en juin lors des frappes israéliennes sur Téhéran, est désormais autour de 60 dollars le baril. Ce recul s’explique par le ralentissement économique mondial, l’apaisement des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et la forte progression de l’offre d’or noir, en hausse de 1,7 million de barils par jour cette année. Cette baisse de prix allège la pression inflationniste : le Fonds monétaire international anticipe une inflation mondiale ramenée à 3,5 % l’an prochain contre 4,2 % en 2025. Mais ce mouvement n’est pas sans conséquences pour la transition énergétique ni pour les majors pétrolières.
Une rentabilité en berne pour les géants pétroliers
Selon Rystad Energy, le bénéfice net des huit premières entreprises mondiales du secteur passera cette année sous les 100 milliards de dollars, contre 108 milliards l’an dernier. Les investissements globaux des majors devraient reculer de 4,3 % en 2025, à 342 milliards de dollars selon Wood Mackenzie. Ces ajustements traduisent une prudence nouvelle des groupes pétroliers face à des cours durablement bas.
Des investissements verts sacrifiés sur l’autel du baril bas
Premières victimes de ce changement de cap, les engagements en faveur des énergies renouvelables. Le directeur général de BP, Murray Auchincloss, reconnaissait déjà avoir « été trop vite » : le britannique supprime 7 000 emplois, réduit de moitié ses investissements dans le renouvelable (entre 1,5 et 2 milliards de dollars) et augmente de 10 milliards ceux dédiés aux hydrocarbures. TotalEnergies abaisse également ses dépenses bas carbone à 4 milliards de dollars par an sur la période 2026-2030, contre 5 milliards précédemment, tout en prévoyant d’accroître sa production de pétrole de 3 % par an.
Des stratégies axées sur la rentabilité et la rémunération des actionnaires
Les groupes cherchent à préserver la rentabilité et la confiance des investisseurs. TotalEnergies maintient un point mort autour de 25 dollars le baril et réaffirme sa politique de dividende, jugée « sacro-sainte ». Si les rachats d’actions seront réduits, plus de 40 % du cash généré restera destiné aux actionnaires. L’objectif est clair : s’affranchir de la conjoncture, même dans un contexte de prix bas.
Une situation climatique aggravée
Alors que la COP30 se tiendra au Brésil du 10 au 21 novembre, le pays vient d’intégrer l’Opep+, le club élargi des pays exportateurs de pétrole. Cette décision contraste avec le constat alarmant d’une année 2024 la plus chaude jamais enregistrée depuis le début de l’ère industrielle, à rebours des ambitions de l’Accord de Paris signé il y a dix ans.
Les tensions commerciales redessinent les flux pétroliers mondiaux
Les cours du pétrole ont récemment rebondi à plus de 62 dollars le baril de Brent, soutenus par la perspective d’une détente commerciale entre Washington et plusieurs de ses partenaires. Les déclarations de Donald Trump sur un « bon accord » à venir avec la Chine, ainsi que ses discussions avec le Premier ministre indien Narendra Modi, laissent espérer une amélioration des échanges internationaux et donc de la demande mondiale de brut.
L’Inde sous pression pour réduire ses achats de pétrole russe
L’Inde, deuxième importateur de brut russe après la Chine, pourrait réduire ses importations de pétrole en provenance de Moscou. En échange, Washington envisagerait d’abaisser les droits de douane sur certains produits indiens de 50 % à une fourchette de 15 à 16 %. Si cette réorientation se concrétise, la Russie verrait son marché se contracter tandis que la demande mondiale pourrait être partiellement rééquilibrée au profit d’autres producteurs.
Des stocks américains en recul, signe d’une demande solide
Les dernières données publiées aux États-Unis confirment une baisse inattendue des stocks de brut de 0,961 million de barils, alors qu’une hausse de 2,2 millions était anticipée. Cette évolution, combinée à l’intensification du raffinage, soutient les cours du pétrole. À Londres, le Brent progressait de 1,48 % à 62,57 dollars, tandis que le WTI gagnait 1,77 % à 58,59 dollars à New York.
Une équation complexe entre économie, géopolitique et climat
Si la baisse des prix du pétrole peut temporairement soutenir la croissance et freiner l’inflation, elle compromet les efforts de décarbonation. En rendant l’énergie fossile moins coûteuse, elle décourage les ménages et les entreprises d’investir dans des alternatives propres. Les majors pétrolières, en quête de marges, ralentissent leurs investissements dans les renouvelables, fragilisant ainsi la trajectoire vers la neutralité carbone. Cette dynamique illustre l’un des paradoxes majeurs de la transition énergétique : sans un prix du pétrole suffisamment élevé, le monde risque de retarder son basculement vers un modèle durable.
Sources : Challenges, Le Figaro, Boursorama
Retour sur la situation début octobre 2025 : Une dégringolade du baril de Brent tirée par la stratégie de l’Opep+
Le prix du baril de Brent est passé de 77 à 63 dollars en 2025, entraîné par la politique de surproduction menée par les membres de l’Opep+, notamment l’Arabie saoudite et la Russie. Depuis avril, le cartel et ses alliés ont relevé leurs quotas de production de plus de 2,5 millions de barils par jour, rompant avec la stratégie de limitation de l’offre adoptée les années précédentes.
Cette inflexion vise à regagner des parts de marché face à la concurrence croissante des États-Unis, du Brésil, du Canada et de la Guyana, dont la production atteint des niveaux proches de leurs records historiques. Les prix du brut ont reculé de près de 8 % en une semaine, le Brent s’échangeant sous les 65 dollars, son plus bas niveau depuis plusieurs mois.
La chute des prix s’explique aussi par une demande en net recul. L’Agence internationale de l’énergie anticipe une croissance de seulement 700 000 barils par jour en 2025 et 2026, tandis que l’Opep reste plus optimiste avec une prévision de +1,3 million. La Chine et l’Europe ralentissent, tandis que l’économie américaine montre des signes d’essoufflement.
Les tensions commerciales initiées par Washington, la guerre en Ukraine et le ralentissement industriel mondial pèsent sur la consommation d’or noir. Dans ce contexte, les analystes anticipent un baril autour de 58 dollars début 2026 et 55 dollars au printemps 2027, confirmant une tendance baissière durable.
Malgré la dégringolade des cours, la baisse reste modérée pour les automobilistes. Théoriquement, un dollar de moins sur le baril correspond à un centime de moins sur le litre de carburant. En pratique, la baisse de 13 dollars du baril depuis janvier 2025 ne s’est traduite que par −8 centimes sur le litre de diesel, freinée par la hausse des coûts de raffinage.
Deux facteurs tempèrent cependant la facture énergétique : la baisse du dollar face à l’euro, qui réduit le coût des importations, et l’écart croissant entre gazole et sans-plomb, favorable aux conducteurs diesel. À court terme, les prix pourraient atteindre environ 1,50 €/L pour le gazole et 1,60 €/L pour le SP95, contre respectivement 1,63 € et 1,73 € actuellement.
Pour éviter une nouvelle chute brutale des cours, l’Opep+ a décidé début octobre d’une hausse modérée de la production : +137 000 barils par jour à partir de novembre 2025. Ce relèvement, confirmé par Reuters et La Tribune, vise à maintenir un équilibre fragile entre stabilisation des prix et reconquête de parts de marché.
La Russie, qui produit actuellement environ 9,25 millions de barils par jour, aurait plaidé pour une augmentation plus prudente, afin de préserver ses revenus pétroliers essentiels au financement de son budget. L’Arabie saoudite, au contraire, pousse pour une relance plus forte, afin d’asseoir son influence sur un marché saturé.
Le marché pétrolier connaît une recomposition majeure. Les États-Unis, le Brésil et le Canada enregistrent une production record, concurrençant directement les pays de l’Opep+. Le choix stratégique du cartel marque une rupture historique : après des années de réduction de l’offre pour soutenir les prix, il privilégie désormais le volume à la valorisation, misant sur la domination du marché à long terme.
Cette orientation accentue la pression sur les prix du brut, au moment même où la demande mondiale demeure atone. Dans ce contexte, les analystes de PVM et Commerzbank évoquent un risque de surabondance durable qui pourrait maintenir le Brent autour des 60 dollars sur l’ensemble de 2025.
Sources : RMC BFMTV, Sud Ouest, Boursorama, La Tribune
Lire aussi :
Baisse du pétrole malgré les tensions Israël-Iran
La remontée des prix du pétrole affecte peu la zone euro
Retour sur la réunion du 3 mai : l’Opep+ relance la production et ébranle les marchés
Samedi 3 mai, les membres de l’Opep+, menés par l’Arabie saoudite et la Russie, ont annoncé une forte hausse de leur production pétrolière pour juin 2025. Ils prévoient d'ajouter 411.000 barils/jour, soit le même volume qu’en mai. Cette décision dépasse largement les 137.000 barils initialement prévus dans leur plan de réintroduction progressive.
Cette annonce a déclenché une onde de choc sur les marchés pétroliers. Dès l’ouverture des échanges en Asie lundi matin, les cours du WTI ont chuté de 3,8 % à 56,08 dollars le baril, tandis que le Brent reculait de 3,5 % à 59,17 dollars. Ce niveau est le plus bas depuis avril, confirmant la tendance baissière des dernières semaines.
Pour Jorge Leon, analyste chez Rystad Energy, cette décision envoie un message clair : « le groupe change de stratégie et cherche à regagner des parts de marché après des années de coupes ». Il s'agit du deuxième mois consécutif de hausse accélérée, portant à 960.000 barils/jour les ajouts de production entre avril et juin.
Ce virage est également motivé par les manquements de certains membres comme l’Irak et le Kazakhstan, qui ont dépassé leurs quotas précédents. L’Arabie saoudite pousse désormais pour accélérer le calendrier de relèvement des quotas, afin de rééquilibrer les efforts au sein du groupe.
Ajay Parmar, directeur de l’analyse pétrolière chez ICIS, estime que cette augmentation de production « ne peut tout simplement pas être absorbée ». Il souligne que la croissance de la demande reste faible, notamment à cause des droits de douane imposés récemment. Le marché est également lesté par les craintes d’une récession mondiale, alimentées par les tensions commerciales initiées par Donald Trump.
Ce déséquilibre entre l’offre et la demande entraîne une baisse rapide et durable des prix. Le pétrole figure désormais parmi les matières premières les moins performantes de l’année 2025.
Face à ce contexte, les grandes institutions revoient leurs prévisions. Morgan Stanley table désormais sur un Brent à 62,50 dollars le baril pour les 3e et 4e trimestres 2025, soit 5 dollars de moins que ses précédentes estimations. De son côté, Barclays abaisse ses prévisions à 66 dollars pour 2025 (contre 70 dollars) et à 60 dollars pour 2026 (contre 62 dollars).
Le cours du WTI pourrait quant à lui approcher la barre symbolique des 50 dollars, un seuil considéré comme critique par plusieurs analystes, dont Brian Leisen chez RBC Marchés des Capitaux.
La réaction des marchés ne s’est pas fait attendre. En Asie, environ 182.000 lots de Brent ont été échangés dans la première demi-heure de cotation lundi, un volume bien supérieur à la moyenne. Cette effervescence illustre l’inquiétude des opérateurs face à l’abondance de l’offre et à l’absence de signaux de reprise de la demande.
L’Opep+ ne compte pas s’arrêter là. Selon plusieurs sources internes, d'autres hausses de production du même ordre pourraient suivre jusqu’en novembre 2025, date à laquelle le groupe envisage de réintroduire jusqu’à 2,2 millions de barils/jour, soit 44 % des coupes décidées depuis 2022.
Sources : Les Echos, Reuters, Apnews
Contributeurs
Chaque jour, nous sélectionnons pour vous, professionnels de la gestion d'actifs, une actualité chiffrée précieuse à vos analyses de marchés.
Statistiques marchés, baromètres, enquêtes, classements, résumés en un graphique ou une infographie dans divers domaines : épargne, immobilier, économie, finances, etc. Ne manquez pas l'info visuelle quotidienne !
Les graphs commentés les plus consultés :
Croissance 2025 : l’Europe à plusieurs vitesses selon Bruxelles
Le cacao à prix d’or : pourquoi le chocolat coûte (beaucoup) plus cher
Un outil pratique mis à votre disposition pour découvrir et vous inscrire aux prochains événements de nos partenaires : webinars, roadshow, formations, etc.

.webp)

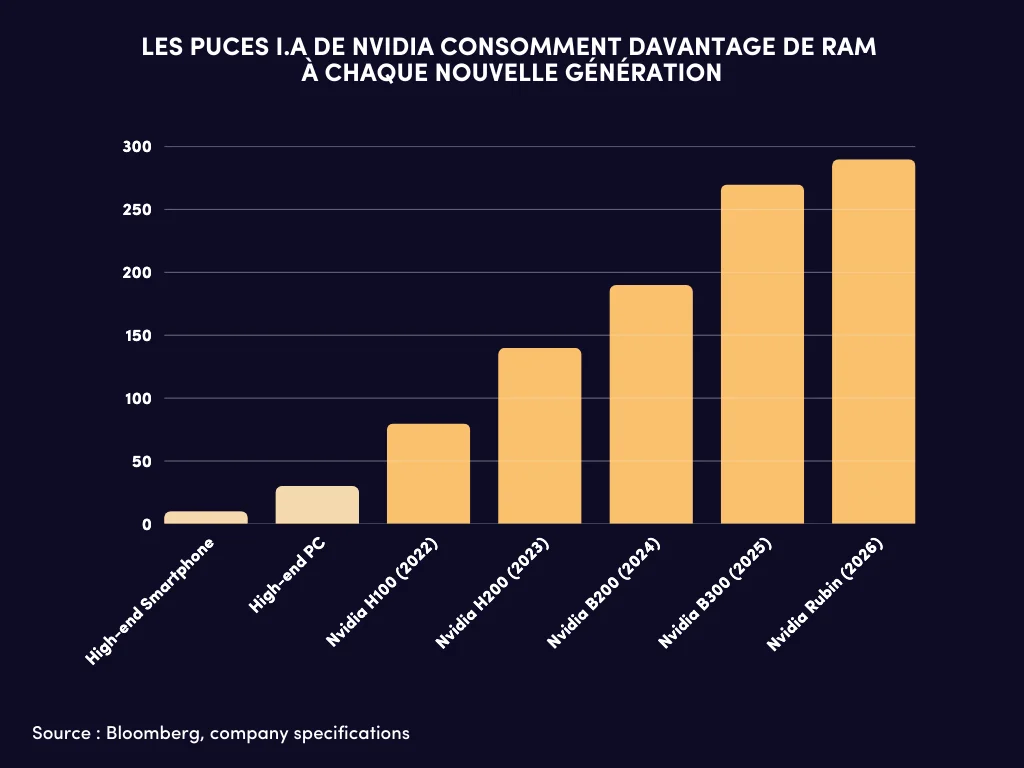



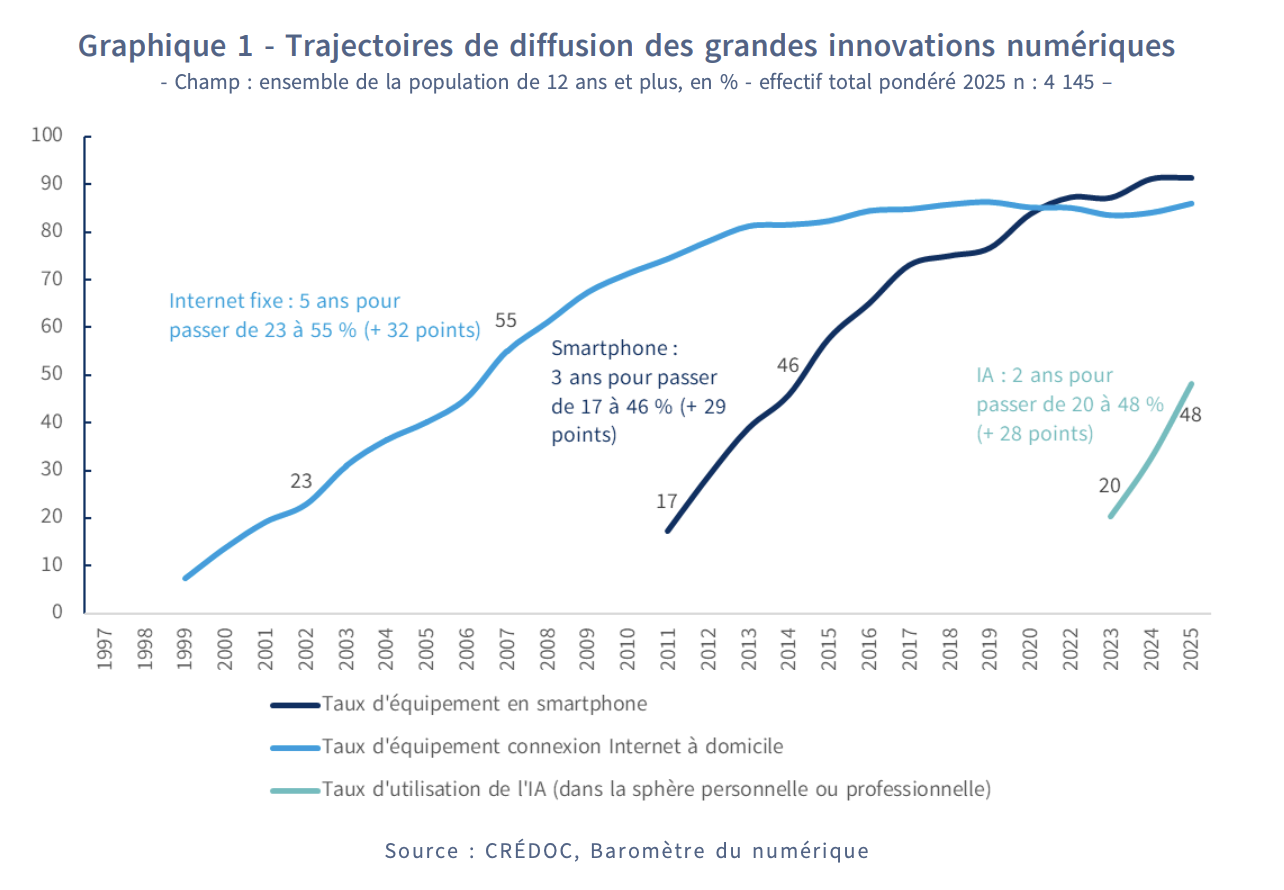
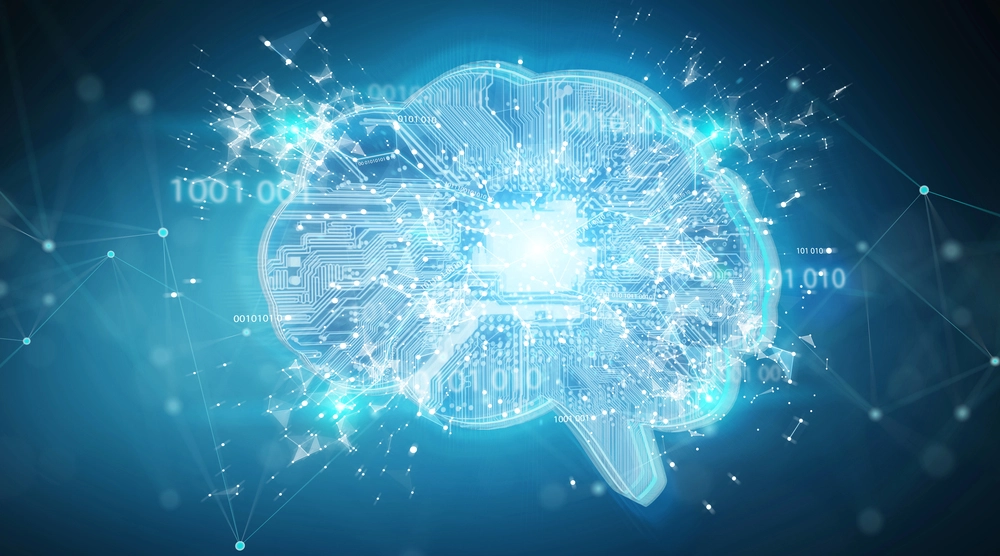
%20(3).webp)








.webp)

















